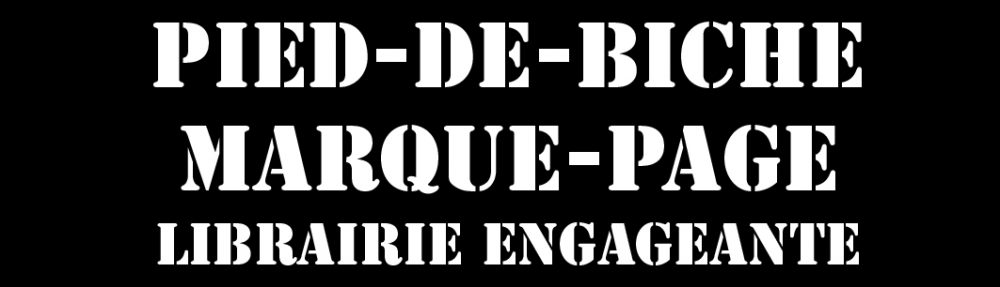Le rap, j’ai arrêté il y a longtemps. Il peut encore m’arriver d’en parler avec la douce nostalgie de l’amoureux déçu et du réducteur «c’était mieux avant». Aussi me méfiais-je de ce «Know what I Mean» présenté comme une analyse socio-politique du mouvement hip-hop. Après, avec une «Intro» de Jay-Z et «Outro» de Nas (oui comme sur un album, tout le livre est structuré ainsi, avec des «pistes» au lieu des chapitres, des «samples» en guise de références… ce qui est plutôt très réussi), ça restait dans ma génération et je l’ai commencé avec curiosité.
Autant le dire tout de suite, je n’ai pas été déçu. Je voudrais vous faire lire toute l’intro de Jay-Z tellement elle est intelligente et percutante. Et tout le livre est du même acabit. C’est un des essais les plus vivifiants et éclairants que j’ai lu depuis longtemps. Et il ne faut surtout pas craindre d’y trouver une synthèse ou une apologie du rap, cela va bien au-delà. Michael Eric Dyson est un des intellectuels noir-américains les plus reconnus quant à l’analyse de la culture hip-hop mais aussi sur l’histoire et toute la culture noir-américaine en commençant par celle des luttes pour les droits civiques. Et c’est dans cette tradition, dans cette vaste analyse sociologique, politique, économique et culturelle que s’inscrit ce texte sur le hip-hop. Il offre une vision réaliste, radicale, sans concession, des conditions d’apparition du hip-hop et de son accession à la culture de masse.
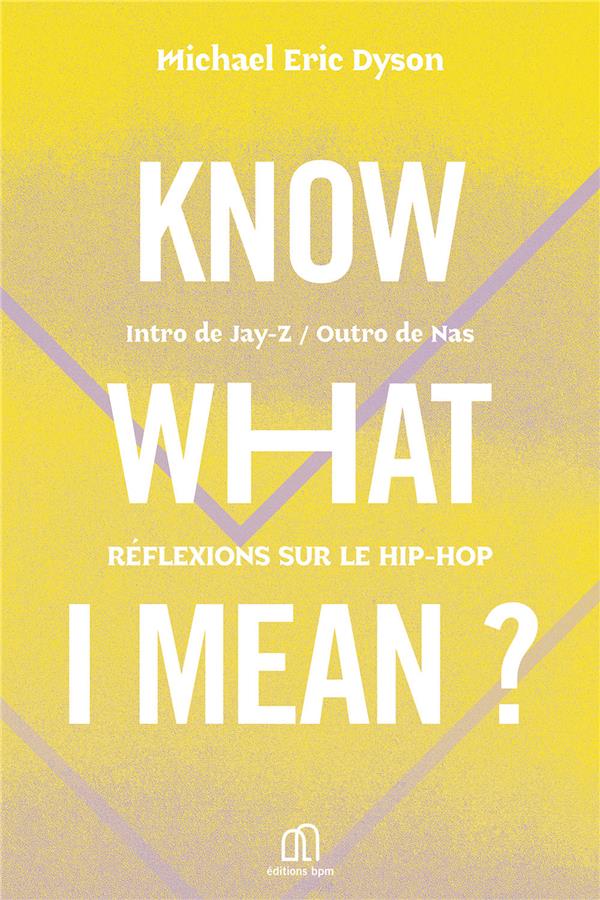
Michael Eric Dyson fournit là un travail exigeant, largement à la hauteur des plus grandes travaux universitaires, nourrit de références sérieuses et précises, et l’applique à ce sujet décrié, souvent relégué à de la sous-culture, qu’est le hip-hop.
On découvre ainsi comment cette culture s’est fondée sur «les restes» de la civilisation industrielle (les réparateurs de platines vinyles des riches blancs ont inventé le scrath et le mix) pour inventer une nouvelle expression culturelle «à partir des fragments de la culture dominante». L’auteur en aborde les impacts politique, économique et sociaux, sans cacher les sujets qui dérangent : sexisme, drogue, homophobie, violence, mais en inscrivant tout cela dans une critique précise et juste du système dominant, nourrie des études les plus actuelles sur ces sujets.
Je m’étonne du peu d’écho qu’il a en France dans la presse spécialisée mais aussi dans la presse généraliste qui gagnerait à enlever un peu ses œillères, car Know What I Mean est un livre que tout amateur de hip-hop devrait lire, mais aussi toute personne désireuse de comprendre tout ce pan essentielle de la culture noire-américaine, qui a en réalité dépassé son seul cadre pour toucher à l’universalité.
Oui, pour paraphraser Nas (je me fais plaisir !), Know What I Mean «fait battre à nouveau le cœur du hip-hop», mais il propose aussi des réponses à bien des questions contemporaines.
Know what i mean ? réflexions sur le hip-hop
de Michael Eric Dyson
(préface Jay-Z ; postface Nas ; traduction conjointe Julien Bordier et Doroteja Gajic)
Bpm Editions – 15 euros
Antonin