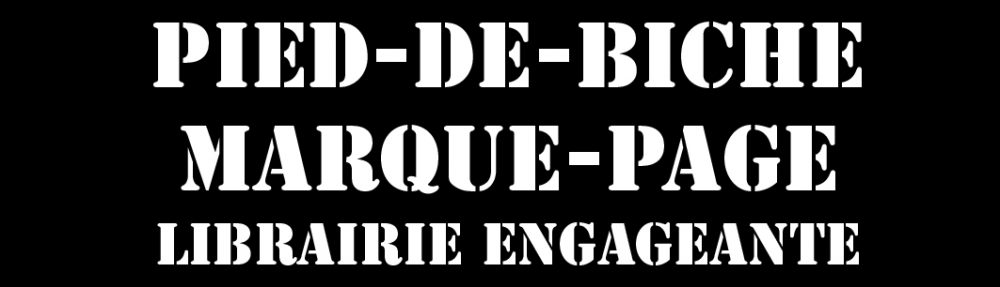Les livres se parlent. Ils se répondent. Et quand les auteurs s’en rendent compte, cela peut donner lieu à des échanges féconds. C’est à cet exercice que nous nous sommes livrés, Damien Deville, géographe et auteur autour de nos livres « La Société Jardinière » et « Le Grand Incendie ».
Bonjour Damien, j’ai lu avec grand intérêt ton livre La société jardinière et y ai trouvé beaucoup des thématiques qui irriguent mes réflexions quand j’écris de la fiction. Tu m’as dit dans un échange que nous avons eu que ton travail s’inscrit dans la veine de la « géographie culturelle » et justement, bien que ton travail de recherche soit affilié à la géographie j’ai été surpris de voir combien il s’attache aux gens, à décrire leur vie, et surtout leur interaction, leur inscription dans la géographie, dans le paysage.
De mon côté, dans Le Grand Incendie, je parle beaucoup de l’importance pour les gens du paysage qui les entoure, avec lequel ils nouent un rapport affectif, intime et intense (et donc le trouble occasionné par la destruction de cet environnement par les mégafeux).
Selon toi, avec ton approche de géographe comment est-ce que la vie des gens s’articule au paysage ?
La géographie culturelle est méconnue. Pourtant elle peut inspirer face aux enjeux contemporains. Son hypothèse principale est que la diversité que l’on connaît à l’échelle du globe émerge de réciprocités permanentes entre les êtres vivants et leur milieu. « L’être se crée en créant son milieu » aime rappeler le géographe Augustin Berque. Autant de réciprocités qui ont été brisées sur l’autel des mondes contemporains, amenant nombre de précarités sociales et écologiques. Au fond, les crises actuelles peuvent s’expliquer par une crise des relations que nous entretenons avec l’autre, humain comme non humain.
Dès lors, il devient important de renseigner les réciprocités nouvelles qui émergent entre nature et culture à l’échelle des territoires. C’est de cette ambition qu’est né le livre la « société jardinière », issu de ma thèse de doctorat. En allant à la rencontre des jardiniers pauvres de la ville d’Alès, j’ai essayé de comprendre comment les activités nouées dans les jardins participent à une trajectoire d’émancipation et à une nouvelle manière d’habiter le territoire.
Lors des enquêtes en géographie culturelle, il est bouleversant de voir à quel point les territoires sont un personnage central dans la vie des individus. Les courbes des paysages guident les esprits, ils façonnent les corps, mais aussi la symbolique, les récits, et de manière plus terre à terre, les opportunités économiques et les projections de vie. Si je prends le cas des jardiniers alésiens, les évolutions de la ville d’Alès ont percuté leurs envies et espoirs. Anciens ouvriers, ils ont vu les mines et les métallurgies fermer. Ils ont vu les opportunités se concentrer dans les grandes métropoles. Ils ont vécu également, pour les plus âgés d’entre eux, la destruction d’un centre-ville médiéval apprécié, à des fins de modernisation de la ville. Alès n’a pas perdu que des vieilles pierres ! Elle a perdu des espaces de fierté, d’appropriation et un enracinement dans le paysage qui l’entoure : les montagnes cévenoles. On revient encore à ces réciprocités brisées. Dans les jardins, les jardiniers fabriquent des espaces dont ils tirent de nouveau fierté.
On ressent également cela dans ton roman « le grand incendie ». Je pense au personnage d’Ianov qui a trouvé dans la forêt sibérienne un moyen de soigner ses blessures de guerre. Je pense également à Asna, contraint à l’exil, par la perte des champs et greniers qui la liaient à son village.
Au fond, on a toutes et tous au fond du cœur un très vieux paysage. Ces liens guident des usages, mais aussi des régimes d’affection. Il y a ici un puissant levier pour inciter chacun à prendre davantage soin du milieu. C’est quelque chose que tu dois également observer en Haute-Loire ?
Tu parles de Ianov, et j’avoue que j’ai tout de suite pensé à lui, quand tu as, dans La Société jardinière, cette phrase très belle et forte : « Lorsque les ruines nous enserrent de toute part, lorsque des paysages aimés sont dévastés, les humains ne se contentent pas de survivre, ils inventent des odyssées uniques. » C’est exactement la même chose ce que je voulais dire avec mon livre !
Ce lien des habitants avec le paysage, je l’ai ressenti très fortement, tout d’abord en venant en Haute-Loire pour des reportages (pour le projet Une Année en France, en 2011) puis en m’y installant moi-même. Je cite souvent Henry David Thoreau, qui dit qu’avant d’aller voir le monde, il faut « connaître son « square mile » », c’est-à-dire, son propre environnement. Cela m’a beaucoup inspiré pour mon premier livre « Nous sommes les Chardons ».
Mais il ne faut pas l’idéaliser non plus. Il y a aussi des gens qui, bien qu’habitant là, se moquent bien que l’on construise des routes inutiles en rasant des forêts et en coupant des montagnes en deux.
C’est peut-être pour ça que cette fois, dans Le Grand Incendie, j’ai voulu montrer, précisément, ce que cela fait de « perdre son paysage ». Radicalement, à cause de feux qui peuvent emporter des surfaces grandes comme la France, qui ne laissent pas repousser les forêts aussi facilement que les feux « normaux », qui effacent tout point de repère. Comment cela bouleverse le rapport au monde.
Je dis, à un moment, que l’ampleur d’une catastrophe « ne se mesure pas en nombre de terrains de football ravagés », mais au « degré de laideur qu’elle ajoute au monde ». Ça aussi, selon moi, illustre le lien qu’on peut avoir au territoire. Et celui-là est évidemment en dehors du circuit marchant, de l’évaluation économique de la valeur d’une terre, d’une forêt ou d’un centre-ville.
Tout au long de ton livre, tu établis un lien entre crise économique et crise paysagère, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec cela ? D’ailleurs, tu ajoutes même que les jardins ouvriers sont une « brèche dans l’architecture libérale de la ville ». Comment ?
Ta question me ramène également à mes anciens travaux, et notamment au livre « Toutes les Couleurs de la Terre » co-écrit avec l’anthropologue et juriste Pierre Spielewoy. Nous avons voulu montrer que nombre de crises sociales et écologiques prennent leur source dans une crise de l’uniformité, une crise de « l’un ». Dit autrement, en appliquant un modèle uniforme d’entreprise, d’aménagement, de projection dans le futur, en modélisant qu’une seule flèche du temps en somme, on laisse sur le bas-côté tous les vivants, humains comme non humains, qui ne veulent ou ne peuvent suivre ce projet.
Cette dynamique d’uniformisation s’observe facilement à l’échelle des territoires. On pourrait résumer leur développement économique à deux grandes politiques totem, à partir desquelles découlent les autres. Les avantages comparatifs d’abord, à partir du tournant de la révolution industrielle. Cette politique a spécialisé chaque région dans une ou plusieurs filières d’excellence. Certaines néanmoins n’ont pas résisté au coup du temps : les hommes du feu, la chaudronnerie, les femmes du fil, le textile, les hommes du noir, le charbon, ont vu leur activité s’écrouler. Par extension, ces territoires, avec une économie essentiellement centrée sur des filières qui n’existent plus aujourd’hui, sont perforés par de nombreux indicateurs de précarité. C’est le cas d’Alès qui répare toujours les blessures de son histoire minière.
Deuxième politique : la métropolisation. Ces grandes villes concentrent les opportunités et les services avec pour risque de placer en vassalité les autres territoires. Mais surtout, la métropolisation standardise la fabrique des imaginaires. Nous avons tendance à associer le progrès et l’émancipation à ces grands centres urbains. C’est un construit politique : il suffit d’aller au cinéma pour se rendre compte que la plupart des films se passent en ville, et comme la France reste un pays centralisé, la plupart des films se passent à Paris ou dans sa proche région. Cela entraîne une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les trois quarts du pays. Le mouvement des gilets jaunes prend racine dans ces multiples gouffres.
À travers ces deux politiques territoriales, on voit bien comment l’uniformité des modèles économiques (les avantages comparatifs) ou des manières de faire espace (la métropolisation) entraîne des dynamiques de précarité. Uniformité et précarité sont toujours les deux temps d’un même processus.
L’uniformité des mondes prend racine dans plusieurs origines. Il y a la dualité entre nature et culture, cette base philosophique de la plupart des mondes occidentaux, mais aussi un modèle économique qui érode les valeurs d’affection, symboliques, d’héritage qui se trouvent initialement dans des échanges marchands. Au fond, notre modèle économique donne un prix à tout, mais de la valeur à rien pour paraphraser Oscar Wilde. Et cela continue de nous déconnecter les uns des autres, et de nous déconnecter des lieux dans lesquels nous vivons. Et, malheureusement, la fabrique des villes elle-même s’ancre dans ces mêmes dynamiques.
Les jardins à Alès procèdent à un chemin sens inverse. Pour faire face à des difficultés structurelles, certains individus retournent à la terre. Ce retour est motivé d’abord par des raisons économiques : se nourrir, nourrir leur famille, gagner un peu de sous par la vente des produits. Mais au fil de la pratique, un apprentissage se met en place, si bien que cette motivation économique devient indissociable de toute une série de motivations (paysagère, sociale, relationnelle) qui participent à l’émancipation globale des individus. Ils retissent le lien, ils redessinent dans la ville des symboles aimés et appropriés, ils se projettent dans le futur non plus simplement par le prisme du coût de la vie, mais par tout un faisceau de valeurs qui les lient de nouveau à la ville. En cela, ils proposent un modèle alternatif, ils forgent une société du lien, une société jardinière.
Cela rejoint également les idées que tu évoques dans le Grand Incendie. Un paysage dévasté, ce sont des couleurs qui nous quittent et donc une projection qui s’effrite. Mais dans le sens inverse, c’est dans les moments difficiles que de nouvelles trajectoires d’émancipation apparaissent. Face à l’incendie, de nouveaux espoirs se lèvent dans le cœur des personnages. Au point qu’ils trouvent la force de traverser une partie du monde.
Comment as-tu pensé ces liens entre désespoir et nouvelles trajectoires d’émancipation ? Est-ce un parallèle avec ce que nous vivons dans les territoires ?
Je crois bien en effet que tout cela est très proche. Beaucoup de gens, après avoir lu Le Grand Incendie, me demandent pourquoi j’ai écrit un livre si sombre, étouffant presque (la disparition des couleurs comme tu dis, c’est tout à fait ça). Mais en l’écrivant, je n’y pensais même pas. Enfin, bien sûr que je voulais montrer le caractère catastrophique du feu, ses effets destructeurs que l’on observe déjà dans les régions soumises aux mégafeux comme la Californie où l’on voit parfois des sortes de « moulages » des racines des arbres, qui ont brûlé si intensément que même leurs racines ont disparu pour ne laisser que leur empreinte. Métaphoriquement, ça me parle des communautés qui se désagrègent aussi bien dans les flammes que dans les ravages causés par la désindustrialisation néo-libérale. Mais, et c’est un » gros mais », je voulais l’écrire en montrant, en valorisant, les trajectoires que les gens prennent suite à cette destruction.
Je ne suis pas un tenant du « perfect storm » ou de la « stratégie du choc » qui comme l’a montré Naomi Klein est une stratégie libérale estimant que la destruction des moyens de vie des gens les pousse vers d’autres productions, vers de nouveaux modes de vie insérés dans le libéralisme, mais je voulais écrire ce que j’espère nous serons en capacité de faire si la catastrophe advient : nous regrouper. Bien sûr les chemins de Ianov en Sibérie, Asan au Kurdistan et même Virginia aux Etats-Unis sont semés d’embûches. Virginia subit même ce que subissent par exemple les migrants africains ou même syriens, chez nous : le rejet. Avec cette sempiternelle question qui leur est posée : pourquoi ne restez-vous pas chez vous à reconstruire, à défendre vos maisons. Mais c’est ne pas voir les effets intimes de la destruction et le besoin de trouver ailleurs le secours et un « nouvel horizon ».
Bref, tous ces gens bousculés, toutes ces particules libérées et mises en mouvement par le feu, se retrouvent et s’assemblent. Dans mon précédent livre, j’écrivais, « l’avenir est aux bosquets » et cette fois, je file la métaphore en disant « l’avenir est aux rhizomes» (encore plus fort peut-être, car c’est sous terrain). Voilà, c’est pour cela que j’ai écrit ce livre joyeusement malgré tout : je pense que l’espoir viendra du commun.
Une dernière question peut-être, qui est liée à cette histoire de rhizomes, tu écris que les jardins sont aune « brèche dans l’architecture libérale de la ville » et surtout qu’ils sont bien éloignés des politiques de verdissement des villes qui, elles ne correspondent pas à un « usage » réel des habitants. Est-ce que tu peux préciser ce que cela implique quant à la réussite de ces politiques, ou sur celles qu’il vaudrait mieux mener à leur place ?
Les territoires, en Occident, sont prisonniers des logiques d’attractivités. Pour eux, une ville ou un village qui réussit, c’est forcément un territoire qui attire et qui dispose d’une croissance démographique et économique forte. Le tout est infusé par les théories urbaines néolibérales post-seconde guerre mondiale venant majoritairement des États-Unis. Parmi les hypothèses qui guident ces théories, celles de l’importance des classes créatives : ces individus à forts capitaux sociaux et économiques qui, par leur capacité d’entrepreneuriat et de création, vont tirer l’image et l’économie d’un territoire vers le haut. Dès lors, le Graal pour chaque commune, c’est d’attirer ces classes créatives sur son territoire.
À Alès, cela se ressent tout particulièrement. La ville investit des montants importants dans des filières qu’elle juge stratégiques : un écosystème de start up, son école des mines, un pôle automobile, des filières alimentaires à forte valeur ajoutée… Et il faut avouer que ces différentes entreprises ont eu chacune des succès économiques. Mais là où le bât blesse, c’est que l’investissement dans ces filières concerne des profils professionnels qui ne sont pas toujours sur le territoire. Autrement dit, la mairie, qui n’a pas des budgets extensibles, investit des sommes importantes pour des gens qui ne sont pas là, qui ne viendront peut-être jamais, aux détriments des familles déjà sur le territoire et qui auraient tellement à apporter si on savait les regarder autrement. Les politiques sociales et d’émancipation des populations précaires sont bien présentes, mais par manque d’ambition et d’investissement, elles restent de l’ordre du symbole.
Le cas des jardins familiaux à Alès permet de l’illustrer. La Mairie a également développé des jardins familiaux dans les quartiers HLM de la commune à destination des habitants précaires. Mais les jardins sont petits, 50 m2 par personne. Ce n’est pas suffisant pour dégager de nouvelles opportunités pour les jardiniers. Et plus important encore, des employés de la mairie contrôlent les pratiques, la bonne tenue des jardins, et imposent aux jardiniers de mélanger les plantes potagères avec des plantes à plus-values esthétiques. L’un dans l’autre, le rôle nourricier des jardins est réduit à sa portion congrue. Cela démontre que le déploiement des jardins par la commune correspond davantage à un agenda d’embellissement de la commune à des fins d’attractivité qu’à celui de redonner aux populations précaires un véritable pouvoir d’agir. D’ailleurs, un fait loin d’être anecdotique, les jardins familiaux développés par la mairie sont mis en visibilité sur le site internet de la commune à partir de l’onglet « Alès, ville fleurie ».
Il y a un immense enjeu à rapprocher les différents récits de la commune, celui qu’en fait la mairie et celui qu’en font les populations en situation de précarité. Car certains projets peuvent aller dans le même sens. Les jardins potagers de la ville sur foncier privé (qui peuvent aller jusqu’à 800m2 par personne) participent aussi à fleurir la ville. Mais ils ont ceci en plus qu’ils sont de véritables épaules contre la précarité. Rapprocher ces visions de la ville demande néanmoins de renouer avec une ambition trop peu déployée en France : la démocratie locale. Les maires ont tendance, dans leur immense majorité, à défendre la décentralisation. Mais paradoxalement, à l’échelle de leur territoire, ils construisent une forme de jacobinisme local, elle-même violente pour les habitants et habitantes, et notamment pour les populations en difficulté. Décentralisation et revitalisation démocratique doivent aller de pair pour répondre aux crises des mondes contemporains.
La Société jardinière – Damien Deville – Le Pommier
164 pages – 18 euros
Le Grand incendie – Antonin Sabot – Presses de la Cité
288 pages – 21 euros