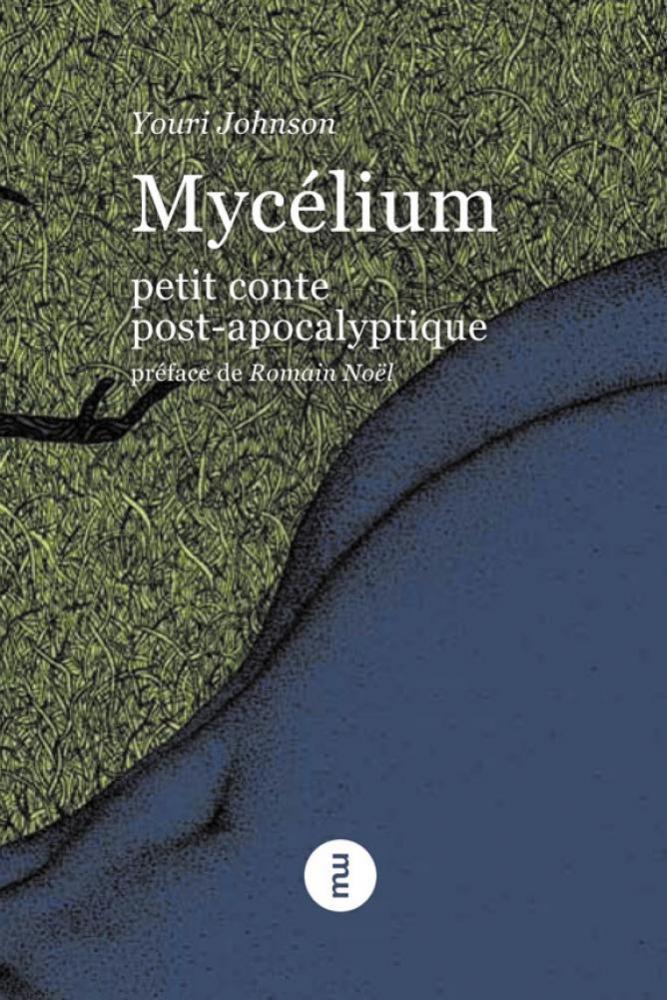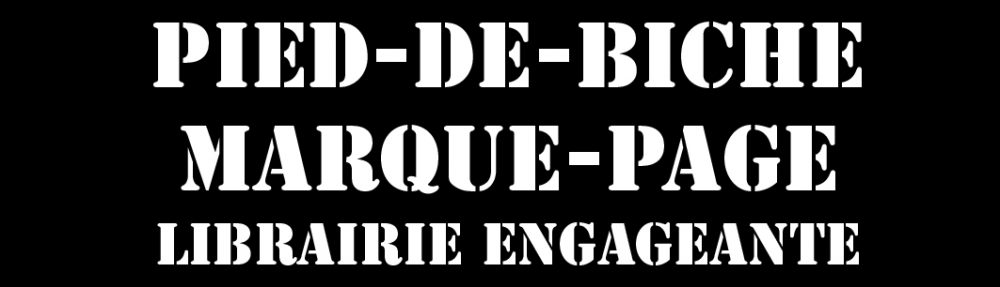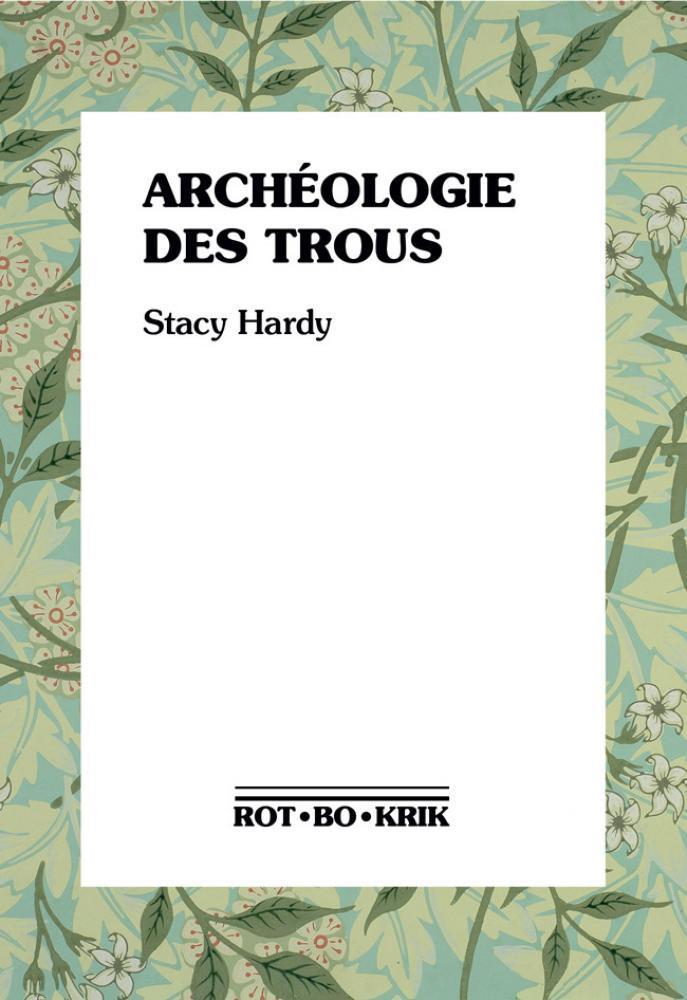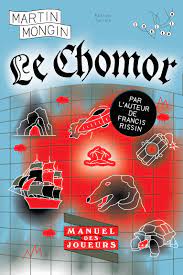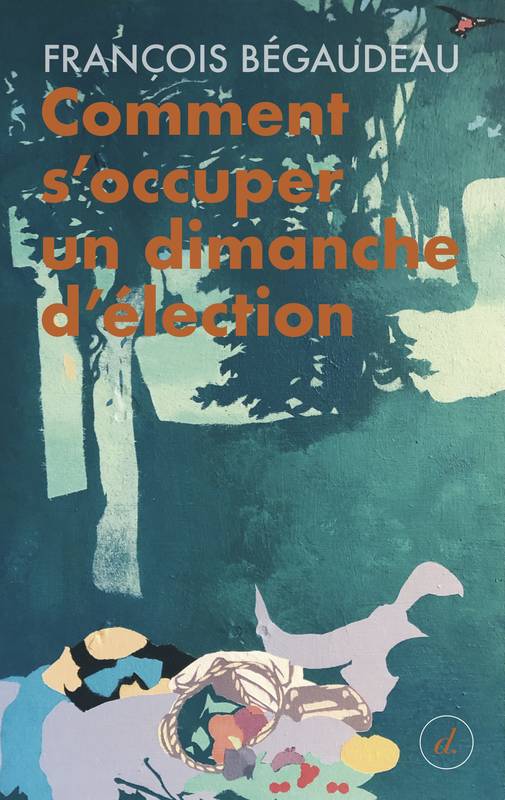« Si l’attribution du label démocrate à un pays incluait dans ses critères, non plus seulement la liberté d’expression, mais aussi la capacité effective de ses habitants à peser sur la distribution des richesses, sur les pratiques de l’élevage industriel, sur l’autorisation de commercialiser un médicament, sur l’achat par des promoteurs de parcelles du littoral, (…) la France ne l’obtiendrait pas. Aucun pays ne l’obtiendrait. »
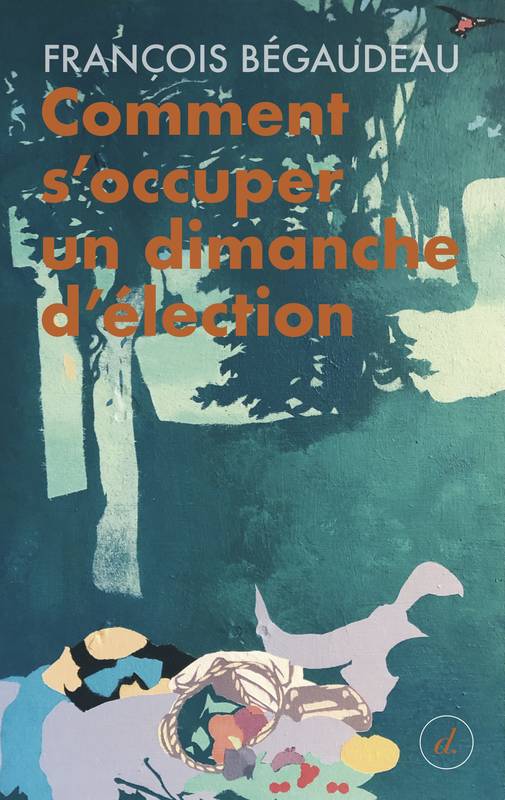
François Bégaudeau est un rhéteur. Aussi ne faut-il pas le croire lorsqu’il déclare au début de « Comment s’occuper un dimanche d’élection » qu’il pratique l’abstention sans la professer, qu’il se moque bien de savoir qui vote ou ne vote pas. C’est tout l’inverse qu’il fait avec ce livre.
Au départ débonnaire quant au sujet du vote, le texte se prétend d’abord une défense de ceux qui ne veulent pas voter, ou plutôt une adresse à ceux qui leur rebattent les oreilles avec le « devoir citoyen » que serait le vote. En cela, difficile de ne pas être d’accord avec l’auteur, le vote ne fait pas la démocratie, les exemples ne manquent pas, même aujourd’hui (ou surtout aujourd’hui ?) de régimes autoritaires parvenus au pouvoir par la voix des urnes.
Et ne venez pas chatouiller Bégaudeau en lui rappelant que « quand même, on a la liberté d’expression ». Il se ferait clair : sans pouvoir d’agir, elle ne sert pas à grand-chose votre liberté d’expression (demandez aux Gilets Jaunes). D’ailleurs vu son goût pour une sorte de situationnisme, on aurait presque préféré en lever le « S’» à « s’occuper » pour ne garder que « Comment occuper un dimanche d’élection » (en mode barricades vous voyez?).
Jusque là, on reste dans le domaine du facile, de l’accepté par presque tous, des arguments auxquels les défenseurs du vote savent rétorquer. On vous fait pas un dessin, vous avez sûrement déjà entendu. Mais, là, le Bégaudeau, il fait ça pour amadouer le votant, pour le mettre en condition. Car ensuite, la critique est plus sévère et franche, plus intéressante aussi. Au vote isolé (on pourrait dire isolant), l’auteur oppose le vote en situation et tous les engagements politiques qui eux ont un vrai sens, car au fil des pages, il fait remarquer qu’on ne dit rien en votant, ou plutôt que l’on peut dire tout et son contraire, ce qui est finalement pire.
Déjà, on entend des gens dans le fond qui rouspètent, il faut dire que la propagande électoraliste nous a tous pris tout petit. Et « gens qui sont morts pour ça », et « si tous les gens de gauche votaient, on gagnerait » (merci Maurice) et « dans les dictatures ils seraient bien contents de voter », on s’arrêtera là, la liste est longue et vous la connaissez. Bégaudeau répond à tout cela avec le sens de la formule qu’on lui connaît −celui qui permet parfois de se passer d’une analyse de fond quand le mot est bon−, mais qu’importe, c’est aussi ce qui fait l’intérêt de ce livre : il est une réponse percutante et sans concession pour ceux qui en ont marre qu’on les prenne pour des dindons et qui ont bien vu que le jeu électoral (car c’est bien souvent par jeu que l’on vote encore et là-dessus Bégaudeau n’a rien à reprocher) est fait par et pour les puissants, qu’il n’a rien d’une concession démocratique si aucun contrôle ne s’exerce après lui, ne fait pas progresser la démocratie voire la fait reculer et finit structurellement par amener les plus droitistes des candidats au pouvoir.
Voilà. Rhéteur je vous disais, François Bégaudeau, car au début de son texte, il voulait vous faire croire que ça lui en touchait une sans faire bouger l’autre, que vous votiez, à la fin vous aurez compris que ce qu’il veut dire, c’est bien que le vote est précisément le vol du pouvoir du peuple (= de la démocratie, pour ceux qui suivent un minimum).
Allez, comme il faut bien un brin d’optimisme dans tout essai digne de ce nom, on partira avec l’idée que finalement, la France de ceux qui ne votent pas (sans compter tous ceux qui n’ont pas le droit même s’ils vivent ici, travaillent ici… non, mais là, soyons sérieux, on vous parle de ceux qui auraient le droit et ne le font pas) est parfois bien plus citoyenne et politisée que celle qui vote, si elle se donne la peine de peser sur la vie de son entreprise, d’aller voir son maire de temps en temps, de réclamer haut et fort ce qu’elle veut vraiment, bref de s’investir, au-delà de deux fois cinq minutes dans l’isoloir tous les cinq ans.
Antonin
Comment s’occuper un dimanche d’élection, de François Bégaudeau, éditions Divergences.
Sortie le 11 mars 2022 (comme ça ça vous donne encore le temps de ne pas aller voter).
14 euros